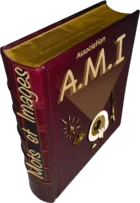Si petite qu’elle soit, la fourmi elle-même a sa colère
« Mais que sert la colère où manque le pouvoir ? » (Pierre Corneille)[1]
Toute petite qu’elle est, poussée à bout, la fourmi pourrait bien se mettre en colère, ce dont elle est parfaitement capable. Autrement dit, il y a des limites à ne pas franchir ! A noter que l’équivalent anglais de ce proverbe est even a worm will turn : même un ver se regimbera, tant une créature aussi inoffensive qu’un ver peut en avoir assez de “se laisser mener par le bout du nez”![2]
Dans sa première satire, dédiée à Mécène son protecteur, le poète latin Horace (65-8 av. J.-C.) écrit ceci : «Il est dans les choses une mesure, des limites certaines, en définitive, / au-delà ou en deçà desquelles ce qui est juste ne saurait exister.»[3] Pièces originales formant à elles seules une œuvre lyrique complète, ces causeries – sermones, en latin – sont des poèmes de tons divers, tantôt mordant, tantôt plus détendu, allant de la satire personnelle à la philosophie morale.
On ne saurait trop insister aujourd’hui sur cette forme de sagesse qu’est la mesure en toute chose, tant notre époque, ne sachant comment se distinguer des précédentes, donne dans ce succédané de perfection illusoire qu’est l’hybris la plus débridée, la démesure en grec, qui prône performances et exploits invraisemblables ! Ne sommes-nous pas sans cesse incités à repousser nos limites dans les domaines les plus divers, à commencer par celui du sport, où l’extrême tend à devenir ordinaire ? Sans oublier l’alimentation ni le consumérisme à outrance : to go beyond limits, to exceed limits, ou to push one’s limits, dit-on en anglais[4].
La première satire du livre I d’Horace pourrait s’intituler l’homme n’est jamais content de son sort, que ce dernier soit le fruit d’un choix délibéré ou de circonstances fortuites. Citant divers exemples à l’appui de son propos, le poète constate que si un dieu accédait aux vœux de ces éternels insatisfaits, qui envient les moyens d’existence d’autrui, personne n’accepterait finalement de troquer sa vie contre la leur ! Et c’est bien là que réside le paradoxe, souvent associé d’ailleurs à l’âpreté au gain. Prenant l’exemple de la fourmi, qui au cours de la belle saison constitue patiemment des réserves, Horace souligne le fait qu’une fois l’hiver venu, elle se contente de consommer dans sa fourmilière ce qu’avec sagesse elle y a accumulé durant l’été[5].
Or, que constate-t-on dans nombre de sociétés humaines ? Loin de se satisfaire de ce qu’il possède, l’homme fera tout, été comme hiver, pour être plus riche que son voisin ! Jalousie, cupidité, colère suscitée par la résistance ou l’échec, orgueil enfin, telles sont les passions, parmi lesquelles les Pères grecs de l’Eglise distinguent huit passions primordiales : la gourmandise, l’impudicité, l’avarice, la colère, la tristesse [selon le monde, car elle engendre la mort spirituelle][6], l’acédie[7], la vanité et l’orgueil. Dans la Tradition de l’Eglise romaine, la colère compte au nombre des sept péchés capitaux, avec l’orgueil, l’avarice, l’envie, la luxure, la gourmandise et la paresse ! Ils sont appelés capitaux du fait qu’ils sont la source[8] d’autres péchés.
Il est de notoriété publique que, depuis des décennies, nos sociétés dites développées sont en proie à un esprit de destruction systématique de tout ce qui est beau, gangrenées qu’elles sont par une violence endémique faite d’agressivité, de vulgarité, d’ignorance, d’hostilité à toute forme de respect, sans omettre l’exploitation éhontée des multiples ressources de notre planète. Or, c’est dans un tel contexte que la connaissance approfondie qu’ont de la nature humaine les Pères de l’Eglise peut nous aider à voir clair dans pareille confusion de valeurs. Dans son homélie intitulée Contre les colériques[9], saint Basile le Grand (329-379), l’un des quatre Pères cappadociens de l’Eglise, décrit avec finesse les effets de la colère dans le cœur de l’homme : signe d’orgueil manifeste, cette sorte de folie momentanée, comme il la définit, est une maladie de l’âme et un obscurcissement de l’esprit, qui éloignent de Dieu et font obstacle à l’Esprit Saint. « Le fou laisse éclater sur l’heure sa colère, mais l’homme prudent avale l’injure. » (Proverbes, 12, 15). Saint Basile donne les moyens de réfréner un tempérament colérique, afin de s’en guérir durablement, par l’humilité et la contrition.
En guise de conclusion, précisons le sens de certains termes : étymologiquement parlant, la colère provient du mot grec cholera par l’intermédiaire du latin, où ce sens est déjà attesté au IVe siècle. Désignant la maladie bien connue, c’est par un rapprochement contestable avec le terme grec de cholè / χολή, qui signifie la bile, que cholera en est venu à remplacer le mot d’ancien français ire, naturellement dérivé du latin ira et qui fut en usage jusqu’aux Temps Modernes. Le grec dispose de deux termes : orgè / ὀργή – qui désigne une colère ayant une cause extérieure, une injustice commise devant témoin, par exemple – et thymos / θυμός, dont la cause est intérieure : un sentiment froissé, le chagrin. C’est ainsi que la théologie grecque distingue ces deux formes de colère, thymos pouvant correspondre à une sorte d’emportement, tandis qu’orgè désigne plutôt un état d’abattement durable, débouchant sur une tendance à la vengeance, comme si l’âme était enflammée du désir de rendre le mal pour le mal. L’une et l’autre sont néanmoins considérées comme très graves, en raison des conséquences qu’elles entraînent. « Que toute amertume, emportement, colère, éclats de voix, calomnies, soient bannis du milieu de vous, comme toute espèce de méchanceté », écrit l’apôtre Paul aux Ephésiens (4, 31).
[1] Sertorius, acte I, scène 2. Pierre Corneille, poète dramatique français qui vécut de 1606 à 1684, est, dès avant le Cid (1636), dont le succès foudroyant fut triomphal, un écrivain important du XVIIe siècle. Il est à juste titre considéré comme le Père du Théâtre français. — Quintus Sertorius (env. 123-72 av. J.-C.) lieutenant de Marius et partisan de celui-ci durant les guerres civiles (88 av. J.-C.), était un général romain fortement impliqué dans la politique de son temps ; il fit la plus grande partie de sa carrière dans la péninsule ibérique, où il s’opposa à Sylla, demeuré maître de l’Italie.
[2] Explication donnée telle quelle par Harrap’s Shorter French and English Dictionnary de 1961 ! — Attestée pour la 1re fois en 1546 dans une collection de proverbes de John Heywood, sous la forme “Treade a worme on the tayle, and it must turne agayne” : marcher sur la queue d’un ver et il peut se retourner, cette phrase idiomatique a été popularisée par William Shakespeare, dans la 3e partie de sa pièce intitulée Henri VI. Il se trouve qu’en ancien anglais worm sous la forme wyrm désigne toutes sortes d’invertébrés, voire des serpents. Qui plus est, dans la mythologie germanique, ce terme peut concerner des êtres quasi mythiques tels des dragons.
[3] Satire 1, livre I, v. 106s. Est modus in rebus, sunt certi denique fines / quos ultra citraque nequit consistere rectum. «Il est une mesure dans les choses, des limites certaines en fin de compte, / au-delà ou en deçà desquelles le bien ne saurait être ». — Quintus Horatius Flaccus naquit en Apulie – les Pouilles actuelles – mais se forma à Rome, puis à Athènes. Présenté par Virgile et Varius à Mécène (Caius Clinius Maecenas, env. 69 – env. 8 av. J.-C.), en 39 av. J.-C., « il sut être discret, plut bientôt et devint indispensable. » (Jean Bayet, Littérature latine, p. 221). Ministre d’Auguste, poète lui-même, Mécène encouragea les lettres et les arts, ouvrant sa maison romaine et sa villa de campagne à des poètes tels que Virgile, Horace et Properce. C’est par métonymie que son nom, devenu commun, désigne un bienfaiteur aidant matériellement des artistes, un protecteur des arts et des lettres.
[4] La revue Santé magazine donne sur internet dix conseils pour y parvenir !… — Remarquons ici ce titre, qui est un calque de l’anglais, car la forme correcte en français est Magazine de santé ! Par l’inversion des termes dont il est formé, ce titre contrevient à l’ordre progressif direct, propre à notre langue, qui va du déterminé au déterminant, énonçant d’abord le sujet, puis l’action ou l’état, enfin le complément.
[5] Cf. la fable bien connue de Jean de La Fontaine (I, 1), intitulée La cigale et la fourmi.
[6] Par l’intermédiaire du désespoir, c’est-à-dire la négation de l’espérance que donne la foi dans les promesses de l’évangile : cf. 2e épître aux Corinthiens, 7, 10. — La tristesse selon Dieu, au contraire, engendre le repentir sincère, qui entraîne la réconciliation avec Dieu, le pardon divin et le salut de l’âme.
[7] Dans la terminologie théologique, l’acédie désigne une forme de négligence, d’indifférence, d’apathie même, souvent liée à la dépression nerveuse. Provoquant la paralysie de l’esprit et de l’âme, cette forme de paresse spirituelle en matière notamment d’observance des commandements divins peut aller jusqu’au mépris de la prière.
[8] Ou tête, qui, en latin, se dit caput, (génitif) capitis ; d’où le terme de capital, qui vient de l’adjectif latin capitalis.
[9] Κατὰ ὀργιζομένων, Patrologie grecque (P.G.) de Migne vol. 31, colonnes 353-372, avec traduction latine due aux moines bénédictins.