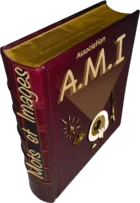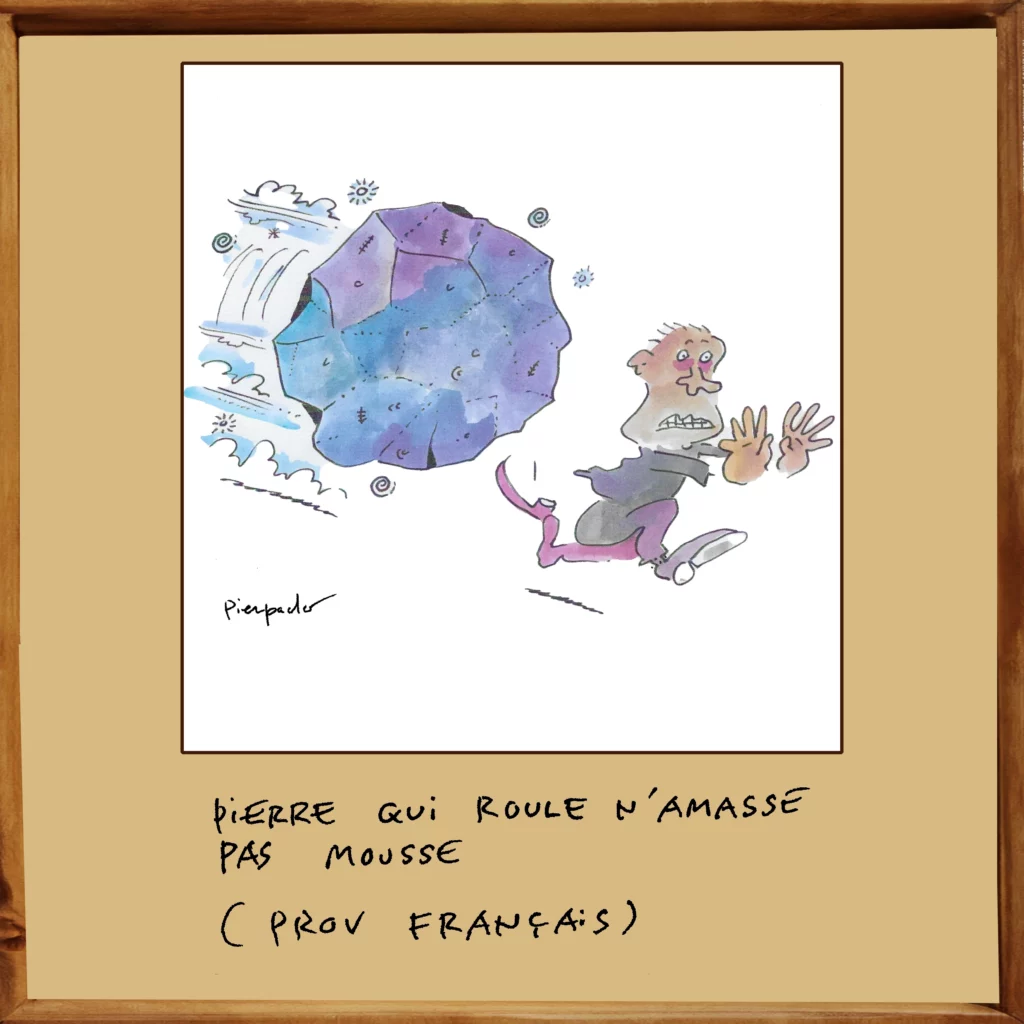
Pierre qui roule n’amasse pas mousse
Rendu célèbre dès le XVIe siècle par les Adages d’Erasme de Rotterdam (1469-1536), ce proverbe d’origine gréco-latine, dont il existe de nombreux équivalents dans les langues romanes[1], signifie que ceux qui passent leur temps à voyager, à déménager, à changer d’emploi ne parviennent pas à se constituer une fortune de quelque importance, ni même à faire des économies. Par extension, une vie instable et dispersée est source d’insécurité matérielle.
Empruntée à la nature, cette image quasi personnifiée recourt à des termes ordinaires, opposant le caractère inerte d’une pierre à celui d’un végétal multicellulaire de constitution simple, appartenant à l’embranchement des bryophytes, lequel est dépourvu d’un vrai système vasculaire et de racines. Proliférant dans les sous-bois humides, les mousses se développent sur divers supports en s’arrimant fortement par leurs rhizoïdes à la surface de ceux-ci.
Comme c’est le cas de nombreux proverbes, la formulation de celui-ci est des plus classiques, puisque les noms pierre et mousse ne sont pas précédés d’un article, contrairement à l’usage du français moderne : une pierre qui roule n’amasse pas de mousse ; cela nous permet d’en faire remonter l’origine au Moyen Age. En ancien français, en effet, les substantifs s’emploient généralement sans article, en particulier dans les proverbes[2] :
Noblesse oblige, pauvreté n’est pas vice, comparaison n’est pas raison, nature est contente de peu, grand prometteur, petit donneur ; à grasse cuisine, pauvreté voisine ; beauté et folie sont souvent en compagnie ; Gourmandise tue plus de gens / qu’épée en guerre tranchant ; Qui vin ne boit après salade / est en danger d’être malade, etc., etc.
Si l’article défini le, la, les apparaît pour la première fois au IXe siècle[3], l’article indéfini un, une, puis des se développe beaucoup plus lentement, et ce n’est qu’à partir du XVIIe siècle que l’emploi en deviendra régulier. Toutefois, même à cette époque, on l’omettait généralement devant certains mots, ainsi que dans diverses locutions, dont beaucoup ont survécu jusqu’aujourd’hui : ne dire mot, en lieu sûr, en cas de pluie, par mauvais temps, quantité de gens, en lieu et place de, etc. Il est bon de rappeler ici ce signe distinctif du français, car de nos jours on use et abuse de l’article indéfini, par imitation servile de l’usage anglo-américain ! Outre les titres de livres du type *Une histoire de la littérature anglaise, *Une introduction aux Fleurs du mal (de Charles Baudelaire), au lieu de Histoire de la littérature anglaise, Introduction aux Fleurs du mal, on entend tous les jours des vœux du type *une bonne journée, *une bonne soirée, indûment substitués à bonne journée, bonne soirée, etc.
Quant au partitif de et à l’article partitif[4], ils apparaissent rarement en ancien français, et encore au XVIe siècle, l’emploi en est plus restreint qu’aujourd’hui. On a commencé par dire, et on a longtemps dit mangier (= manger) pain, avoir cuer (= cœur), boire vin, etc.
O lui venoient duit vaslet / Qui portoient et pain et vin.
Avec lui venaient deux valets, qui portaient du pain et du vin. (Chrétien de Troyes)
A la Renaissance, notre proverbe a la teneur suivante : Pierre souvent remuée / De mousse n’est velée (= couverte d’un voile, comme une religieuse).
En voici les ancêtres antiques : en grec, Λίθος κυλιόμενος φῦκος οὐ ποιεῖ : pierre roulée ne fait pas d’algue ; en latin : musco lapis volutus haud obducitur : pierre roulée ne se couvre pas de mousse ; ou : saxum volutum non obducitur musco : rocher (littéralement pierre brute) roulé ne se couvre pas de mousse ; enfin, mais dans un registre un peu différent, saepius plantata arbor fructum profert exiguum : un arbre trop souvent transplanté est chiche en fruits[5].
Ces adages nous ayant été transmis principalement par des anthologies de diverses époques, il est difficile d’attribuer tel ou tel proverbe à un auteur en particulier. Erasme lui-même dut puiser à plusieurs sources : pour les Grecs, il recourut certainement à la Collection Apostolius intitulée Proverbes (Paroimiae / Παροιμίαι) de Michaël Apostolios (1420-1478), père d’Arsène (1465-1536), auteur d’une anthologie d’apophtegmes de philosophes, de généraux et d’orateurs ; pour les Latins, il a probablement consulté, même s’il ne le dit pas, les Sententiae (Pensées, sentences) de Publius Syrus, un auteur de mimes vivant au Ier siècle avant notre ère.
Devenu un véritable topos de l’instabilité, notre proverbe existe dans diverses langues modernes : en italien, Pietra mossa non fa muschio et Pietra che va rotolando non coglie mosche ; en espagnol : Piedra movediza nunca moho la cobija ; en anglais : A rolling stone gathers no moss ; en allemand : Auf rollenden Steinen sammelt sich kein Moos.
Nous conclurons cette présentation avec le philosophe français Alain, de son nom officiel Emile Auguste Chartier (1868-1951), auteur de quelque cinq mille Propos :
« C’est Kant le premier, je pense, qui a fait voir que la raison, autre nom de l’esprit, procède par maximes, et que les maximes ne sont pas des vérités ; les maximes sont régulatrices. […] Il ne faut pas moins que cet avertissement, si nouveau encore maintenant, si éloigné de nos notions abstraites et raides sur le vrai et le faux, si l’on veut apprécier les proverbes. Les proverbes ne sont point d’entendement, mais de raison[6]. Ils ne concernent jamais la nature des choses, mais ils visent à régler la nature humaine, et vont toujours à contre-pente contre les glissements qui nous sont naturels.
» Pierre qui roule…, cela n’est pas vrai. Les rassis[7] n’ont pas besoin de ce conseil. Mais il y a dans beaucoup, et surtout dans les jeunes, un besoin de changer et une illusion qui s’y rapporte. Tout nouveau, tout beau, cela n’est point non plus une vérité des choses ; car il ne manque pas de nouveautés qui ne méritent point cette ironique remarque.
» C’est ainsi que les proverbes, en leur variété, nous mettent en garde contre tous les genres de précipitation, qui sont les causes les plus communes de nos erreurs, et bien plus redoutables que la difficulté de connaître, qu’on exagère toujours. Dans le fait, et comme on l’a dit et redit, nous sommes assez clairvoyants quand il s’agit du voisin ; si, au contraire, nous sommes en cause, nous nous trompons aussitôt et comme naturellement sur ce que nous savons d’ailleurs assez. C’est pourquoi chacun veut se croire au-dessus des proverbes et se trompe en cela. »[8]
(jjr)
[1] Issues du latin dit vulgaire, ou populaire, soit un latin fortement simplifié, servant de moyen de communication à des locuteurs de toutes sortes et de culture rudimentaire, ces langues sont l’espagnol, le français, l’italien, le portugais, le provençal, le roumain, ainsi que le catalan, le rhéto-roman, le sarde et le dalmate
[2] Contrairement au grec, le latin ne connaît pas l’article. Or le français est principalement d’origine latine.
[3] Dans la Cantilène de sainte Eulalie. — A l’époque de la Chanson de Roland, soit trois siècle plus tard, il a des emplois bien délimités ; il ne s’emploie pas devant des mots dénués d’extension, c.-à-d. des êtres ou des objets uniques : terre est grande, ciel est immense, ni devant des noms d’extension illimitée : liberté, beauté, santé, etc.
[4] Le partitif s’emploie lorsque, dans un tout nombrable, c.-à-d. dont on peut compter les éléments, on prélève une quantité parfaitement indéterminée. C’est par abus de langage que l‘on considère la préposition de comme un article partitif ! « Marquant proprement le point de départ ou l’extraction, de est apte à marquer la partition au sens premier et ancien du terme », à savoir la division en parties. (G. et R. LE BIDOIS, Syntaxe du français moderne, vol. I, § 136). Il est donc plus correct de l’appeler forme réduite de l’article partitif, laquelle s’oppose à la forme pleine : de la, de l’, du, des.
[5] Attribué à tort au philosophe latin Sénèque (L. Annaeus Seneca), né à Cordoue vers le début de l’ère chrétienne et mort en 65 – en s’ouvrant les veines dans sa baignoire sur l’ordre de Néron, dont il avait été le précepteur – cet adage rappelle une phrase qu’on lit dans une lettre à Lucilius (2, 3) : Planta quae saepe transfertur non coalescit : une plante qui est souvent déplacée ne prend pas racine.
[6] Dans la langue philosophique, on appelle entendement la faculté de comprendre, c.-à-d. l’ensemble des facultés intellectuelles. Quant à la raison, elle désigne la faculté de penser, de raisonner, c.-à-d. de bien juger et d’appliquer ce jugement à l’action. (Petit Robert, s.v.)
[7] Participe passé du verbe rasseoir, cet adjectif signifie pondéré, réfléchi : on l’utilise encore dans l’expression être de sens rassis. Il ne faut pas le confondre avec celui du verbe rassir, que l’on emploie pour le pain, la pâtisserie, la viande, etc.
[8] Propos d’Alain, “Proverbes”, 20 juin 1933, Bibliothèque de la Pléiade, T. I, p. 1161s.