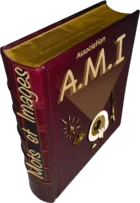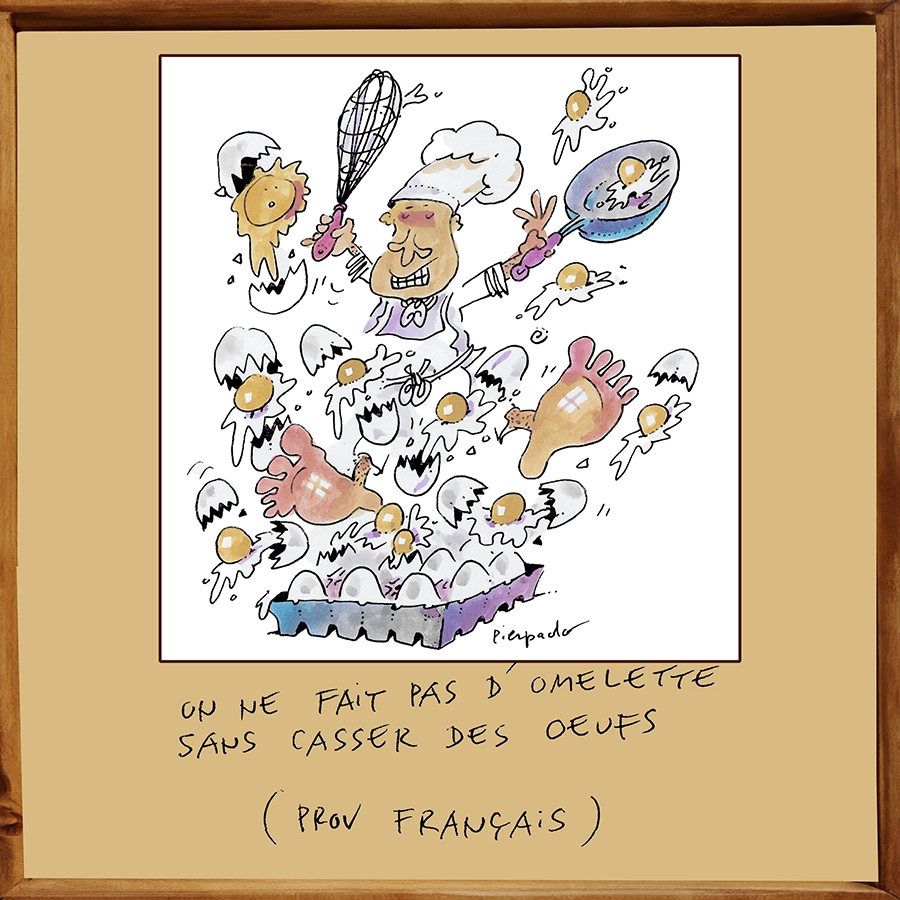
On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs
En effet, et cela tombe sous le sens ! Mais alors, si c’est évident, pourquoi en a-t-on fait un proverbe ? Pour son sens figuré, répondra-t-on, ce qui ne contribue guère à nous éclairer, puisque c’est là d’ordinaire sa nature et même sa raison d’être, un proverbe étant une pensée courte, de portée générale et de valeur souvent morale, devenue familière ou populaire, dont la forme est néanmoins métaphorique[1].
Dès lors, quel est le sens sous-jacent du proverbe qui nous occupe ? A noter qu’il en existe une variante : On ne fait pas d’omelette sans casser les œufs, c’est-à-dire ceux que l’on destine à ce mets[2]. Cette locution figurée signifie qu’il y a « des pertes inévitables, des sacrifices à faire pour ceux qui veulent atteindre certains buts. »[3] Ah ! là, on quitte la cuisine pour d’autres domaines…
Sans vouloir entrer dans de grandes considérations métaphysiques, étant donné que l’œuf renferme la vie en puissance, sa valeur symbolique est très ancienne ; aussi le retrouve-t-on dans nombre de civilisations, ainsi que dans les cultes de la Déesse Mère, ce qui lui vaut d’être très tôt associé au principe féminin, puisque la femme donne la vie. Déjà dans l’Antiquité, il était de coutume d’offrir des œufs au printemps, en signe de renouveau et de renaissance de la nature. Ayant repris cette tradition, le christianisme la perpétue : à Pâques, fête commémorative de la Résurrection de Jésus Christ, on offre des œufs teints – en rouge traditionnellement, en souvenir du sang versé sur la Croix – symbolisant la victoire remportée par la Vie sur la mort. Ainsi, loin d’être, comme dans les rêves par exemple, un symbole de nourriture seulement, l’œuf symbolise en fait un devenir, car il contient à l’intérieur de sa coquille des substances de réserve ; bref, il ne renferme rien de moins que le miracle de la vie à venir[4].
On comprend dès lors que casser un œuf est plus qu’une simple opération culinaire, voire un malencontreux accident, d’autant que sa forme ovoïde, elle aussi, est de nature symbolique, puisque, par sa perfection rappelant celle d’une sphère, elle est signe d’unité du monde. Ne représentait-on pas l’Univers sous la forme d’un œuf cosmique, exprimant l’ordre naissant, émergeant du chaos primordial ? C’est pourquoi l’image triviale de notre proverbe prend un aspect moral certain.
Ainsi, pour en revenir au sens de celui-ci, qui signifie prosaïquement que l’on n’a rien sans rien – nothing comes from nothing, dit-on en anglais – il faut être prêt à perdre, à sacrifier quelque chose, même d’une certaine valeur, si l’on veut parvenir à ses fins. C’est d’ailleurs ce qui se produit, bien souvent, au jeu d’échecs…
Perte, sacrifice : deux concepts qui ne sont guère prisés de nos jours, d’autant que, réputés peu glorieux, ils sont bien souvent considérés comme des échecs… Or ces deux termes riches de sens, métaphysiques à l’origine, ont des emplois divers.
Dérivant du verbe sacrifier, qui étymologiquement signifie faire une cérémonie sacrée, le sacrifice a d’abord désigné une offrande rituelle faite à Dieu, dans la religion juive ancienne notamment, ainsi que dans le paganisme, où l’on fait des sacrifices sanglants à des divinités et à des idoles. « N’ayant rien d’un acte magique de transfert des péchés à la victime, c’est un don, un moyen d’union ou d’action de grâces, un moyen d’expiation. »[5] Dès l’époque de la Renaissance, passant dans le domaine profane, le mot prend alors un sens métaphorique : il désigne par métonymie la victime d’un sacrifice et acquiert petit à petit le sens figuré de renoncement, de privation volontaire en vue d’une fin[6], ce qui rejoint une des acceptions matérielles du mot de perte.
Pour en revenir au sens de notre proverbe, la perte n’est en fait qu’apparente, puisque les œufs cassés en deux sont transformés en omelette et non perdus, comme ce peut être le cas lorsque l’on brise un œuf par maladresse. Ressortissant à l’origine au domaine culinaire, l’évidence signalée au début de ce petit commentaire a donc un fondement moral, raison pour laquelle elle est passée en proverbe.
[1] D’après René BAILLY, Dictionnaire des synonymes, Librairie Larousse, 1947, entrée Pensée.
[2] A noter que si la tournure de la phrase est négative, on peut omettre l’article [indéfini] et n’employer que le de partitif : on ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs. En revanche, quand la tournure de la phrase est affirmative, c’est obligatoirement le de partitif que l’on emploie : il parle sans faire de faute(s), c.-à-d. sans aucune faute.
— Ajoutons que l’idée négative de sans est telle qu’il est erroné de faire suivre la locution conjonctive sans que d’un ne négatif, même confondu avec un ne explétif, qui est tout aussi fautif (solécisme). C’est ainsi que des phrases telles que elle lui avait été présentée sans qu’il °ne se souvienne d’elle, ils ont emménagé sans que des travaux °n’aient été entrepris etc., sont fautives. Quant à la phrase J’ai été condamné sans que je °ne le sache, elle est doublement fautive : outre la particule négative ne, l’identité de sujets entraîne l’infinitif ; il fallait donc écrire : j’ai été condamné sans le savoir !!! Une proposition introduite par sans que se rattache aux phrases du type ils n’ont pas d’amis, elle n’a pas de travail, etc.
[3] Maurice RAT, Dictionnaire des locutions françaises, Larousse, 1957, s.v.
[4] C’est probablement à Johan Jakob Bachofen (1815-1887), auteur entre autres d’un ouvrage important intitulé Le Droit maternel (Das Mutterrecht, trad. française d’Etienne Barilier (1996), que l’on doit les plus belles pages et les considérations les plus profondes sur le symbolisme de l’œuf. — Prière à tout lecteur germanophone (mais non pas seulement !) de communiquer aux auteurs la référence exacte, s’il la connaît, de l’ouvrage où l’on lit ces considérations.
[5] A.-M. GÉRARD, Dictionnaire de la Bible, Paris, éd. Robert Laffont, 1989, entrée sacrifice, p 1216.
[6] Le ROBERT, Dictionnaire historique de la langue française, T. II, s.v.