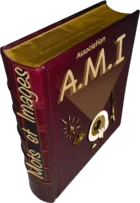Le mieux est l’ennemi du bien
Avant d’être un proverbe, le mieux est l’ennemi du bien est une citation tronquée d’une réflexion de Montesquieu, figurant dans ses Pensées ; n’étant pas destinées à la publication, celles-ci ne parurent intégralement qu’au milieu du XXe siècle[1]. La citation exacte est le mieux est le mortel ennemi du bien. On conviendra que l’adjectif omis lui confère gravité et absoluité[2], ce qui n’est pas le cas de la forme passée dans l’usage et devenue proverbiale. Entrée dans la langue au XVIIIe siècle, cette maxime – dont c’est en français la plus ancienne attestation – se lit également sous la plume de Voltaire (1694-1778), qui en attribue la paternité à un sage italien :
Dans ses écrits un sage Italien,
Dit que le mieux est l’ennemi du bien.
Non qu’on ne puisse augmenter en prudence,
En bonté d’âme, en talents, en science ;
Cherchons le mieux sur ces chapitres-là ;
Partout ailleurs, évitons la chimère.
Dans son état, heureux qui peut se plaire,
Vivre à sa place, et garder ce qu’il a.[3]
Passée d’abord dans l’usage français, puis traduite, sous la forme que nous lui connaissons, dans un grand nombre d’idiomes, cette citation serait donc d’origine italienne. Quoi qu’il en soit, ceux qui ne sont jamais contents de leur sort, qui ne cessent de désirer ce qu’ils n’ont pas, ne saisissant même pas qu’ils risquent de perdre ce qu’ils ont, seraient bien avisés de méditer ce sage précepte !
Mettant en garde contre le perfectionnisme et l’excès de zèle, manifestations d’ambition excessive, sinon d’orgueil et de démesure, cette maxime nous rappelle opportunément que la perfection n’est pas de ce monde ! On comprend dès lors pourquoi Montesquieu considère le mieux comme le mortel ennemi du bien. Non seulement on risque de gâcher une chose à force de vouloir l’améliorer, mais on finit par tomber dans un piège que l’on se tend à soi-même, menant tout droit à l’enlisement, voire à l’échec. Il faut se contenter de faire de son mieux, améliorer ce qui peut l’être objectivement, faire ce qui est possible et accessible ; cette attitude, parfaitement subjective, est une forme d’équilibre personnel liée aux moyens dont on dispose, lesquels varient d’une personne à l’autre. Rien de trop disaient les Anciens : mèdènn ágan / μηδὲν ἄγαν, ce qui en latin donne ne quid nimis[4]. On est donc bien loin de la perfection, prétendu gage d’excellence.
En outre, le mieux étant un superlatif, soit le degré supérieur d’un système de comparaison, il n’en est pas moins relatif, lié qu’il est au bien lui-même, toujours susceptible d’être amélioré. Enfin, l’obsession de la perfection par amélioration constante reflète une illusion fondamentale, une chimère comme dit Voltaire, liée à la crainte de manquer, d’être mal jugé, de ne pas être à la hauteur, bref à une forme d’insatisfaction existentielle. Or, quand on est obsédé par le mieux, on finit même par rejeter le bien !
Qu’en est-il sur le plan spirituel ? Dans le Sermon sur la montagne, quintessence de l’enseignement résolument nouveau que donne le Fils de Dieu par rapport à l’enseignement traditionnel, le Christ déclare que ceux qui suivront les préceptes qu’il a énoncés « <seront> parfaits comme <leur> Père céleste est parfait »[5].
Contrairement à la perfection illusoire de ce monde, cette perfection chrétienne passe par la modestie, l’humilité, la sainteté. Or la quête obsessionnelle de la perfection, souvent assortie d’arrogance, aura pour celui qui en est victime de fâcheuses conséquences : égoïsme personnel, critique d’autrui, isolement social ; la perte de contact avec la vie réelle et ses défis, entraînant à son tour la perte du sens de la réalité, finit par entraver le développement personnel et spirituel et conduire au désespoir, lequel peut mener à l’abandon de tout effort tendant à l’amélioration de soi.
Ainsi, que l’on soit croyant ou non, le perfectionnisme à outrance, loin de passer pour une vertu, n’est en fait que l’expression d’une insatisfaction foncière. Pablo Picasso (1881-1973) disait : « Une peinture n’est jamais finie. Mais un jour, on décide de l’arrêter. »
[1] Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) — Ce titre est celui d’un recueil en trois volumes contenant des notes et des réflexions, qui prennent parfois la forme de maximes ; elles ont été prises par l’auteur au cours de ses lectures, de conversations, de rencontres, d’expériences même, qu’il a notées en vue de l’élaboration de ses ouvrages. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces Pensées ne s’inscrivent pas dans la lignée des Mémoires intérieurs de l’empereur et philosophe romain Marc-Aurèle (121-180), ni des Pensées du philosophe chrétien Blaise Pascal (1623-1662).
[2] Au sens de caractère absolu, ce terme est un néologisme philosophique datant de la fin du XIXe siècle.
[3] Début d’un conte moral en vers intitulé La Bégueule, publié en 1772. La citation originale italienne est : « Il meglio è l’inimico del bene ».
[4] Cette célèbre maxime était gravée sur le fronton du temple d’Apollon à Delphes. Elle est attribuée à Solon, l’un des Sept Sages de la Grèce, « le plus ancien des poètes et de tous les écrivains athéniens ; né vers 640 av J.-C., il mourut octogénaire ». (R. FLACELIÈRE, Histoire littéraire de la Grèce, p. 122). Quant à son équivalent latin, on le lit dans l’Andrienne, une comédie du poète comique latin Térence (vers 190/185-159 av. J.-C.)
[5] Matthieu, 5, 48.