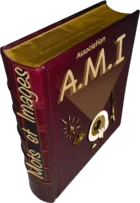C’est la montagne qui accouche d’une souris. (proverbe français)
La montagne qui accouche
Une montagne en mal d’enfant
Jetait une clameur si haute
Que chacun au bruit accourant
Crut qu’elle accoucherait, sans faute,
D’une cité plus grosse que Paris :
Elle accoucha d’une souris.
Quand je songe à cette fable
Dont le récit est menteur
Et le sens véritable,
Je me figure un auteur
Qui dit : « Je chanterai la guerre
Que firent les Titans au maître du tonnerre. »[1]
C’est promettre beaucoup, mais qu’en sort-il souvent ?
Du vent.
Jean de La Fontaine[2]
Horace[3], le poète latin à qui est empruntée cette image devenue proverbiale, a su en un seul vers énoncer une vérité éternelle : les belles promesses sont à prendre avec la plus grande circonspection, car, comme conclut le fabuliste en deux mots, en deux syllabes même, c’est du vent. Il est si difficile de les tenir, ces belles promesses…
Récit menteur, mais sens véritable ! “Un narratif”, comme on croit bien dire aujourd’hui !
On appelle “narratif” un « récit utilisé comme technique de communication en politique, en marketing, en management, destiné à renforcer l’adhésion du public aux idées d’un homme politique ou d’un parti, à une marque, à une entreprise, etc. »
Renforcer l’adhésion du public : tout un programme !… Et l’entrée du dictionnaire de donner un exemple de l’emploi de ce curieux vocable d’origine adjectivale : cette entreprise a su créer un narratif fédérateur[4].
Créer : la belle affaire ! Le voilà, ce verbe, dont le premier sens, le sens propre, est tirer quelque chose du néant, ce que fit Dieu, le Créateur[5], comme le rappelle Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) au début de son Discours sur l’histoire universelle : « La première époque vous présente un grand spectacle : Dieu qui crée le ciel et la terre par Sa parole et qui fait l’homme à Son image ».
Et pourtant, cela ne nous empêche pas de créer à tort et à travers, d’accommoder ce verbe à toutes les sauces. Citons ici, en l’étendant à nombre de nos contemporains, indépendamment de leur domaine d’activité, ce que dit des romanciers François Mauriac (1885-1970) : « L’humilité n’est pas la vertu dominante des romanciers. Ils ne craignent pas de prétendre au titre de créateurs. Des créateurs ! Les émules de Dieu !
» Les personnages qu’ils inventent ne sont nullement créés, si la création consiste à faire quelque chose de rien. Nos prétendues créatures sont formées d’éléments pris au réel ; nous combinons, avec plus ou moins d’adresse, ce que nous fournissent l’observation des autres hommes et la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Les héros de romans naissent du mariage que le romancier contracte avec la réalité. »[6]
Est-il de nos jours un champ d’activité qui échappe à ce fléau rhétorique qu’est l’inflation du style ? Car l’inflation n’est pas que monétaire : elle affecte tous les domaines, de la politique à la gastronomie, de la mode à la finance, de la publicité à la santé, sans oublier la presse, la langue administrative, les médias en général. L’enflure verbale sévit partout, car en matière de promesses et de projets notamment, tout est prétexte à hyperboles, à pléonasmes, à néologismes ronflants et à anglicismes rampants, calqués sur l’anglo-américain. Sans parler des innombrables égos en mal de reconnaissance : politiques, artistiques, sportifs et autres. Que ne ferait-on pas pour repousser ses limites, pour sécréter de l’adrénaline à haute dose !
En ces temps de mondialisation galopante, où la démesure – l’hybris / ὕβρις, principal ressort de la tragédie grecque – le dispute à l’égoïsme, il est bon de rappeler cette notion essentielle de la conception que se faisaient de l’univers les Grecs de l’Antiquité : l’ordre moral lui-même, dont Zeus, le roi des douze dieux de l’Olympe, est pour eux le garant, est gravement compromis lorsque l’homme, en proie à une insatiabilité et à un un orgueil effrénés, transgresse la mesure divinement imposée à la nature humaine, cette juste mesure qui, selon l’adage attribué à Cléobule de Lindos (VIe s. av. J.-C.) est de toutes la meilleure : métron áriston / μέτρον ἄριστον.
.
[1] Début classique d’un poème épique. — Nés de la Terre et du Ciel (Gaïa et Ouranos), les Titans, très nombreux, ressemblaient à certains égards aux premières créatures, qui étaient des monstres. Trois d’entre eux avaient cent bras et cinquante têtes, et trois autres reçurent le nom de Cyclopes en raison de leur œil unique au milieu du front, aussi grand qu’une roue (kyklos en grec). Ouranos n’aimant pas sa monstrueuse progéniture, enfermait ces monstres, dès leur naissance, au centre de la terre, épargnant toutefois Cyclopes et Titans. Sur l’ordre de sa mère, l’un de ceux-ci, Cronos, punit son père de sa dureté de cœur en le mutilant horriblement, tandis que des gouttes de son sang surgirent les Géants, la quatrième race de monstres. Lorsqu’ils furent tous chassés de la surface de la terre, Cronos et son épouse Rhéa (Saturne et Ops en latin), régnèrent durant des temps immémoriaux. Or Zeus, leur sixième enfant, se révolta contre son père. Lors d’une guerre terrible opposant Cronos, aidé des Titans, à Zeus et à ses cinq frères et sœurs, assistés par les Cyclopes et les monstres primordiaux, ces derniers vainquirent leurs adversaires. Zeus était désormais le maître du tonnerre et de la foudre. Et ce furent les débuts de l’humanité, tandis que Cronos, qui avait trouvé refuge en Italie, y fit longtemps régner l’Age d’Or, une ère de paix parfaite et de bonheur, chantée par les poètes latins.
[2] Fables, livre V, 10.
[3] La source de cet apologue – dont la dernière strophe s’inspire des vers qui le précèdent immédiatement – est le vers 139 de l’Epître aux Pisons, très tôt appelée l’Art poétique d’Horace (65-8 av. J.-C.), lequel vivait à l’époque de l’empereur Auguste : “parturient montes, nascetur ridiculus mus” : les monts (pluriel emphatique) en gésine enfantent une souris ridicule. — Les dédicataires de cette œuvre de près de 500 vers, les Pisons, qui n’ont pas été identifiés avec certitude, sont membres d’une grande famille romaine, la gens Calpurnia.
[4] Dictionnaire Larousse, s.v. — Bel exemple de galimatias contemporain, où, entre autres innovations, les adjectifs substantivés sont légion.
[5] V. le premier chapitre de la Genèse. — Autres sens de ce verbe : inventer, imaginer ; produire, susciter ; fonder, instituer. (P.-E. LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, t. I, s.v.)
[6] François MAURIAC, Le Romancier et ses personnages.